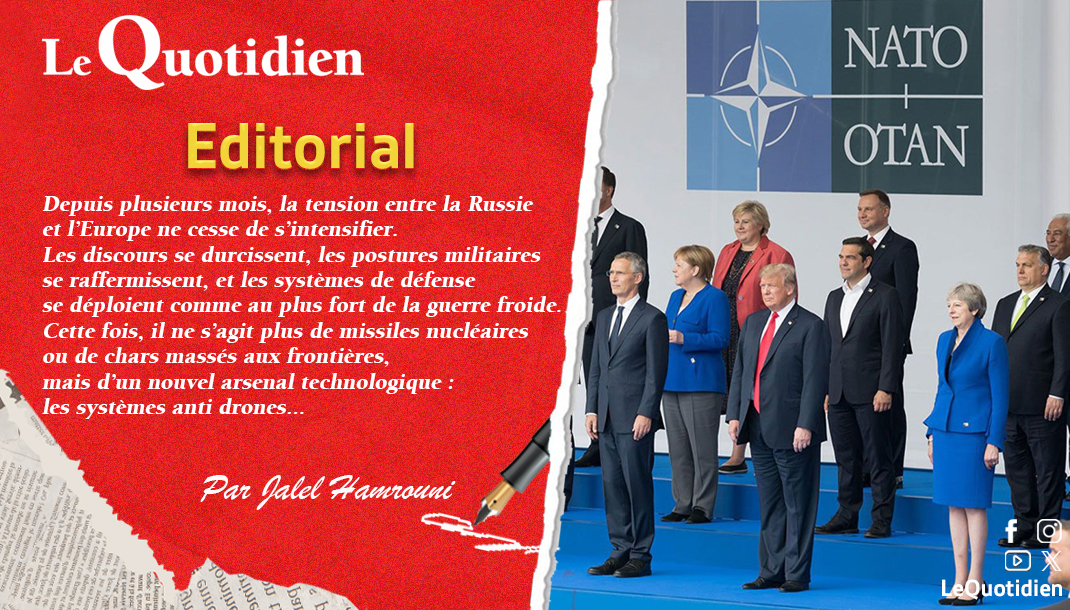Par Jalel Hamrouni
Depuis plusieurs mois, la tension entre la Russie et l’Europe ne cesse de s’intensifier. Les discours se durcissent, les postures militaires se raffermissent, et les systèmes de défense se déploient comme au plus fort de la guerre froide. Cette fois, il ne s’agit plus de missiles nucléaires ou de chars massés aux frontières, mais d’un nouvel arsenal technologique : les systèmes anti drones.
Ces machines silencieuses, capables de détecter, brouiller ou abattre les drones ennemis, incarnent la nouvelle frontière de la confrontation militaire. Pourtant, derrière cette modernité apparente, se dessine un scénario que l’Europe a déjà connu : celui de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les alliances se nouaient dans la méfiance, les provocations s’accumulaient, et que l’orgueil national se mêlait à la peur d’un déclin.
L’Ukraine est devenue, une fois de plus, le théâtre d’un affrontement par procuration entre Moscou et l’Occident. Tandis que la Russie renforce ses capacités de guerre électronique et multiplie les frappes de drones kamikazes, les pays européens, soutenus par l’OTAN, installent en urgence des boucliers anti drones le long de leurs frontières orientales.
L’Allemagne, la Pologne et la Lituanie, en particulier, investissent massivement dans des technologies capables de neutraliser ces menaces. Berlin parle d’une « guerre invisible », mais tout indique que cette guerre n’est plus seulement invisible : elle est imminente.
La rhétorique des deux camps rappelle étrangement celle des années 1930. À l’époque déjà, les puissances européennes pensaient pouvoir contenir la montée en puissance d’un régime autoritaire par des alliances défensives et des démonstrations de force. Aujourd’hui, c’est la même logique : une course à la dissuasion où chaque avancée militaire de l’un devient le prétexte d’un renforcement de l’autre.
Les systèmes anti drones européens ne sont pas seulement des outils de protection, ils sont devenus un symbole de souveraineté et de défi envers Moscou. Dans les capitales occidentales, on redoute l’expansion de la guerre en Ukraine vers les pays baltes ; à Moscou, on perçoit chaque radar installé comme une provocation directe, un pas de plus vers un encerclement.
Les parallèles avec la Seconde Guerre mondiale sont d’autant plus troublants que le climat politique européen s’assombrit. La peur, la propagande et les discours nationalistes refont surface. Les appels à la « défense de la civilisation européenne » rappellent étrangement les slogans d’avant 1939. La Russie, quant à elle, rejoue sa vieille partition impériale : celle d’une puissance encerclée, trahie par l’Occident, contrainte de réaffirmer sa grandeur par la force.
Dans ce théâtre géopolitique saturé d’émotions et de symboles, les drones ne sont qu’un instrument, le symptôme d’une confrontation plus profonde — celle de deux visions du monde irréconciliables.
Le champ de bataille de demain ne sera pas celui de Stalingrad, mais celui du cyberespace, des satellites, et des essaims de drones autonomes. Les guerres ne se gagnent plus seulement par les chars et les bombes, mais par les données, l’intelligence artificielle et la supériorité électronique.
C’est une guerre sans visages, sans héros, sans gloire — une guerre où la frontière entre agresseur et défenseur devient floue, car chaque attaque numérique peut être niée, chaque drone abattu peut être présenté comme une erreur technique.
Cependant, la mécanique de la peur reste la même. Comme en 1938, les diplomates multiplient les réunions d’urgence, les alliances se reforment, les budgets militaires explosent, et les opinions publiques s’habituent peu à peu à l’idée de l’inévitable. L’Europe, qui croyait avoir tourné la page des guerres sur son sol, redécouvre la fragilité de sa paix. La Russie, de son côté, semble déterminée à tester jusqu’où l’Occident est prêt à aller pour défendre ses principes. Les deux camps avancent sur une ligne fine, celle qui sépare la dissuasion de la provocation.
Le plus inquiétant est que cette montée des tensions s’accompagne d’une banalisation du discours guerrier. Les mots « conflit », « frappe préventive », « neutralisation », ou « riposte immédiate » envahissent les médias comme s’ils faisaient partie du langage courant. L’Europe s’arme, la Russie réplique, et la spirale s’accélère. Comme dans les années 1930, personne ne veut la guerre, mais tout le monde s’y prépare.
Ce qui manque, aujourd’hui comme hier, c’est la voix du raisonnable, celle qui rappelle que la sécurité ne peut être durable si elle repose uniquement sur la peur. La leçon de la Seconde Guerre mondiale n’est pas seulement que la paix se défend, mais qu’elle se négocie. Si l’Europe et la Russie persistent à dialoguer à travers des drones et des radars, elles risquent de réveiller les fantômes d’un passé qu’elles prétendent pourtant avoir dépassé.
J.H.