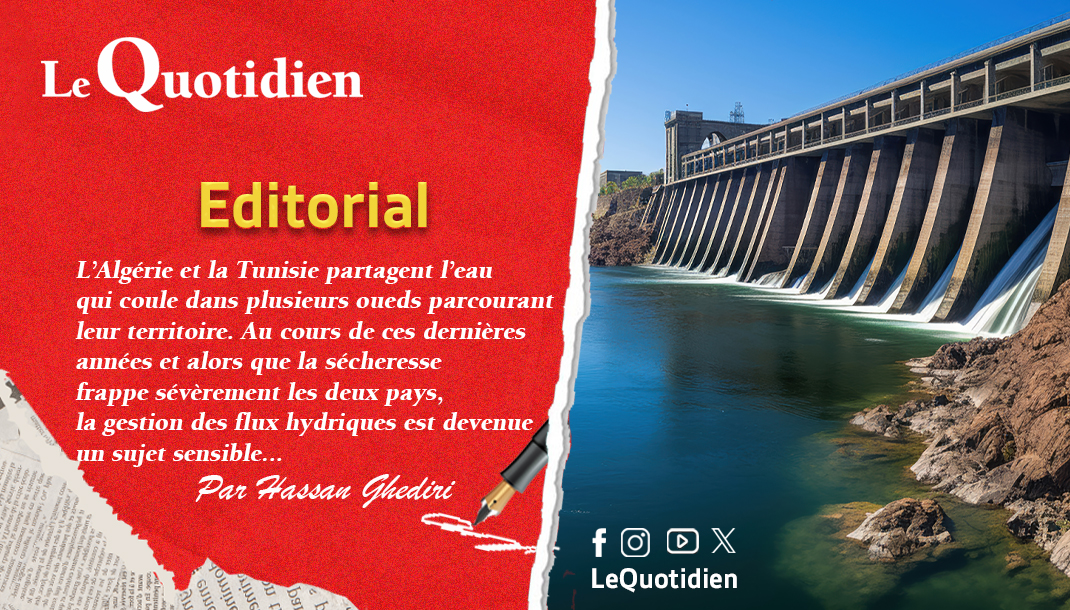L’Algérie et la Tunisie partagent l’eau qui coule dans plusieurs oueds parcourant leur territoire. Au cours de ces dernières années et alors que la sécheresse frappe sévèrement les deux pays, la gestion des flux hydriques est devenue un sujet sensible. Pourtant, la «grande sœur» n’a jamais hésité à multiplier les ouvrages hydriques en faisant sortir de terre de nouveaux barrages sur la longueur des fleuves qui traversent les frontières communes avec notre pays. Au cours de ces derniers jours, un des plus importants barrages en Algérie a été déclaré plein à 100%, ce qui a donné lieu à des lâchers massifs vers la Tunisie. Un évènement qui a suscité des réactions mitigées mettant au grand jour le débat sur l’épineuse problématique de l’eau transfrontalière.
En fait, l’Algérie a considérablement renforcé son infrastructure hydraulique au cours de la dernière décennie. Depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui, pas moins d’une trentaine de nouveaux barrages ont été construits dans les différentes wilayas du pays, dont plusieurs en amont des oueds partagés avec la Tunisie, tels que l’oued El Kebir et oued Mellègue. A l’heure actuelle, notre voisin de l’ouest dispose de plus de 80 barrages opérationnels totalisant une capacité de stockage d’environ 9 milliards de mètres cubes d’eau..A titre de comparaison, la Tunisie ne compte que la moitié de ce nombre pour une capacité globale de rétention dépassant à peine les 2 milliards de m3. Ce déséquilibre marquant au détriment de la Tunisie qui voit sa marge de manoeuvre se rétrécir considérablement sous l’effet d’un stress hydrique chronique auquel elle s’expose et qui réduit de manière drastique la disponibilité de l’eau douce par habitant qui est aujourd’hui largement inférieure à celle de l’Algérie. En fait, tandis qu’Alger peut toujours compter sur des ressources annuelles avoisinant 12 milliards de mètres cubes, la Tunisie se trouve obligée de se contenter de ressources de plus en plus infimes.
Au cours de ces dernières années, l’Algérie a notamment renforcé l’un des plus vastes barrages d’Afrique du Nord, en l’occurrence celui de Beni Haroun qui a vu sa capacité croitre de plusieurs millions de mètres cubes. Plusieurs autres ouvrages majeurs avaient cependant été construits ou renforcés dans des régions limitrophes de la Tunisie. L’on peut par exemple citer les wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Khenchla et El Tarf dans lesquelles émergent de grands barrages et où prennent source de nombreux oueds traversant ensuite la frontière avec la Tunisie. Des barrages situés à quelques encablures du territoire tunisien et qui permettent à l’Algérie de contrôler des quantités colossales d’eau avant qu’elles ne traverse la frontière. En effet, on peut compter aujourd’hui environ une quinzaine de barrages et de retenues d’eau dans les wilayas frontalières, totalisant une capacité de plusieurs centaines de millions de mètres cubes dépassant largement celles des barrages tunisiens comme Bouhedma situés à l’autre côté de la frontière et érigés sur le même chemin emprunté par l’eau dans son long voyage vers le littoral. La Tunisie, qui s’active à rattraper son retard qu’elle accuse par rapport à son voisin limitrophe dans cette course aux barrages, dispose de 40 barrages d’une capacité totale de rétention, (réduite par l’envasement) estimée à plus de 2 milliards de m3. Soit à peine le quart de la capacité algérienne plaçant notre pays en-dessous du seuil critique fixé par l’ONU en ce qui concerne l’accès de la population à l’eau potable.
La politique hydrique appliquée en Algérie axée sur les ressources alternatives telles que le dessalement mais aussi sur les solutions conventionnelles caractérisées par la multiplication des barrages soulève des interrogations légitimes du côté tunisien. Les lâchers massifs comme ceux opérés cette semaine vont certes permettre d’alimehter les nappes et les barrages, soulève des interrogations légitimes du côté tunisien. Les lâchers massifs enregistrés récemment vont certes permettre de ravitailler nappes et barrages en Tunisie mais ils reposent avec insistance la question de la gestion concertée des eaux transfrontalières qui devient plus que jamais une urgence stratégique.
Face aux multiples défis liés à la sécurité hydrique, la Tunisie et l’Algérie doivent faire bien mieux dans un cadre de concertation renforcée. D’où la nécessité d’une coopération claire et permanente pour éviter aux deux pays les malentendus et les tensions. Il est en effet impératif de placer la question de l’eau au centre du dialogue bilatéral. L’eau doit rester un facteur de rapprochement et de solidarité, et jamais un sujet de discorde.
H.G.