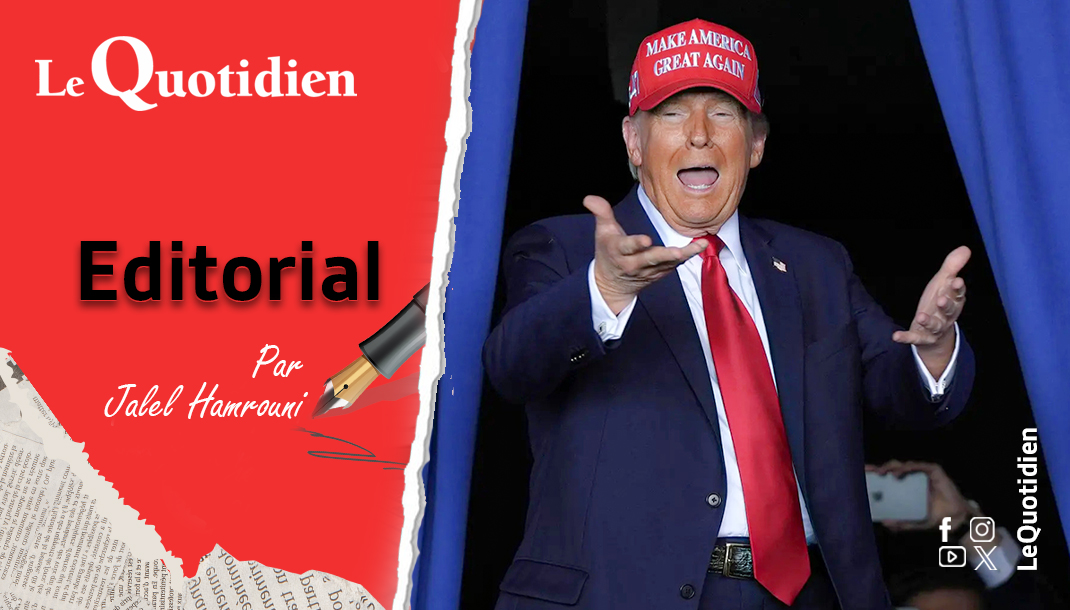Tout au long de sa campagne électorale, Donald Trump a proféré une série de menaces contre l’OTAN et a menacé de se retirer de cette alliance militaire. Une manière de faire pression sur les États membres pour qu’ils augmentent la marge des dépenses de défense.
Après son investiture, Trump a, encore une fois, brandis la menace de se retirer de l’OTAN. Il a même déclaré qu’il encouragerait les Russes à faire «ce qu’ils veulent» à tout membre de l’OTAN qui ne paierait pas ses factures.
Les récentes déclarations du nouveau locataire de la Maison Blanche ont ravivé les craintes d’un désengagement américain de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, pays qui reste la force motrice de cette alliance.
La menace de Trump a, donc, semé la panique sur le Vieux Continent. «Je ne vous protégerai pas si vous ne payez pas» a-t-il rétorqué.
La menace de Trump visait spécifiquement les États membres de l’OTAN qui n’affectent pas 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Mais, au-delà des mots, les États-Unis peuvent-ils vraiment quitter l’OTAN et mettre fin à leur présence militaire en Europe ?
L’OTAN a été fondée en 1949 et comprenait initialement 12 États membres, dont les États-Unis, mais il se compose désormais de 31 membres. Ils sont tous liés par 14 articles seulement, dont le fameux article 5 qui implique une réponse collective contre l’agresseur contre tout État membre de cette alliance.
L’article 13 stipule qu’après que ce traité soit resté en vigueur pendant 20 ans, toute partie peut se retirer un an après en avoir soumis une notification au gouvernement des États-Unis, qui informera les gouvernements des autres parties, du dépôt de chaque instrument de retrait.
Dans cette situation, comment les États-Unis eux-mêmes peuvent-ils se retirer ? Cela nécessite, selon les experts, l’ajout d’un texte procédural, car à part l’article 13, il n’existe aucune procédure indiquant ce qu’un pays doit faire s’il souhaite quitter l’alliance.
Ainsi, tout départ des États-Unis entraînerait une révision du fonctionnement de cette alliance en elle-même. Durant son mandat de 2016 à 2020, Trump n’a épargné aucune critique à l’égard de l’OTAN qu’il considère comme une organisation dépassée, mais certains de ses conseillers proches ont su freiner ses tendances isolationnistes.
En décembre 2023, le Congrès américain a adopté une loi stipulant qu’aucun président ne peut suspendre, mettre fin, dénoncer ou se retirer de l’adhésion des États-Unis à l’OTAN sans une loi émise par le Congrès ou l’approbation des deux tiers des membres de l’OTAN.
Ça n’empêche que les actions de Trump demeurent imprévisibles. Il faut donc faire des suppositions fortes sur ce qu’il va faire au cours de son mandat. De ce fait, un éventuel retrait américain de l’OTAN est-il inévitable ?
Les États-Unis sont profondément liés à l’OTAN en termes de planification et de déploiement de forces, les infrastructures et les bases américaines en Europe sont vitales pour le déploiement des forces de Washington au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, et dans une grande partie du reste. L’argent que les pays européens dépensent pour la défense va aux entreprises de défense américaines, qui créent des milliers de postes d’emploi et réalisent de bons bénéfices aux États-Unis, ce qui exclut l’idée d’un retrait de Trump de l’alliance.
Les Européens, quant à eux, n’ont plus aucun choix que se soumettre aux souhaits du Trump pour éviter l’effondrement de l’OTAN. Un effondrement qui sera fatal notamment dans la conjoncture actuelle.
J.H.