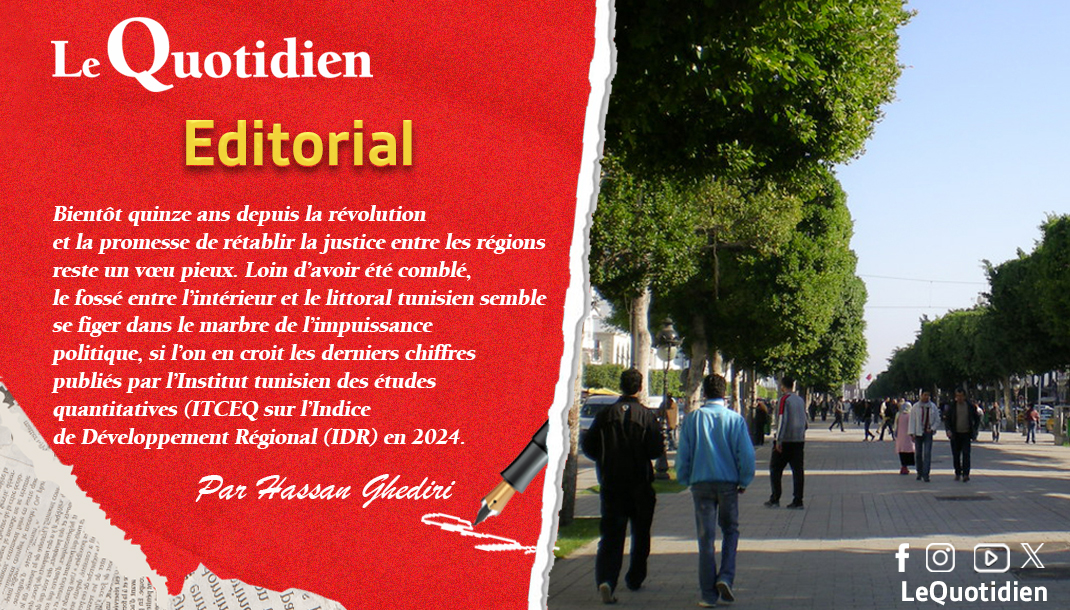Bientôt quinze ans depuis la révolution et la promesse de rétablir la justice entre les régions reste un vœu pieux. Loin d’avoir été comblé, le fossé entre l’intérieur et le littoral tunisien semble se figer dans le marbre de l’impuissance politique, si l’on en croit les derniers chiffres publiés par l’Institut tunisien des études quantitatives (ITCEQ sur l’Indice de Développement Régional (IDR) en 2024. Cette étude, méthodique et rigoureuse, établit un contrat sans appel : les mêmes régions, depuis longtemps bien nanties, occupent le haut de l’échelle, les autres éternellement défavorisées sombrent dans la marginalité. Pendant plus d’une décennie, qui a vu défiler pas moins d’une douzaine de gouvernements, d’innombrables plans de développement, des réformes et des loi de finances vantées comme inclusives, la situation n'a pas changé d’un iota.
Après le 25 juillet 2021 et les promesses de rompre avec les inégalités, le bilan devrait être plus reluisant. Beaucoup reste toutefois à faire, car, selon l’ITCEQ, les moteurs de développement sont restés désespérément en panne. Au cours des quatre dernières années, l’IDR national a stagné (pour ne pas dire reculé) se situant à 0,461 en 2024, contre 0,462 en 2021. Rien que cette donnée résume à elle seule la défaillance systémique d’un pays qui peine à faire avancer son développement territorial. Pire encore : cinq des sept facteurs clés qui composent cet indice ont régressé, en l’occurrence l’accès aux soins, aux loisirs, à l’emploi, le tissu entrepreneurial, les filets sociaux. Dans un pays étranglé par les tensions économiques et financières, ce sont les territoires déjà fragiles qui trinquent le plus, à l’image de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Jendouba ou Béja, victimes inconsolables de la marginalisation.
Depuis 2011, chaque nouveau pouvoir a promis monts et merveilles aux régions dites défavorisées. Aucun n’a tenu parole. Les investissements promis manquent toujours de prendre forme. L’emploi de masse reste un rêve inaccessible, le service public tombe en ruine, les hôpitaux se vident de leur personnel, les infrastructures se dégradent, poussant des générations de jeunes et de moins jeunes à déserter les régions vers de nouveaux horizons plus prometteurs. Une migration intérieure et extérieure qui vide le pays réel de ses forces vives.
Ironie de l’histoire : c’est précisément au nom de ces inégalités qu’un peuple s’était levé contre le régime déchu. Quatorze ans plus tard, les visages ont changé, mais les fractures, elles, se sont durcies. L’outil statistique de l’IDR, désormais affiné jusqu’au niveau des délégations, ne laisse plus de place au doute : la Tunisie ne souffre pas d’un simple retard, elle est structurellement divisée.
Le régime actuel semble, aussi, incapable de briser ce cercle vicieux. La centralisation a la peau dure et ne cesse d’être paradoxalement accentuée par une disparité territoriale flagrante et un manque flagrant de politiques publiques ciblées. Résultat : un modèle de développement tourné vers la rente, favorisant les zones côtières et réduisant à néant l’ambition de justice spatiale. Faut-il alors s’étonner que la défiance citoyenne enfle à chaque rendez-vous électoral, que la démobilisation gagne les esprits, que le désespoir s’empare des âmes ?
Il ne s’agit plus aujourd’hui de rééquilibrer pour « réparer », mais de reconstruire autrement : à partir des besoins réels, des ressources locales, de l’écoute des acteurs du terrain. À condition toutefois que la volonté politique suive. L’heure n’est plus aux diagnostics, mais à l’action.
H.G.